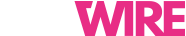Il est communément admis que la valeur d’une nation est intrinsèquement liée à celle de sa jeunesse. De la même manière, la qualité de cette jeunesse dépend étroitement de son niveau d’éducation et de formation. Ainsi, plus une jeunesse est instruite, consciente et bien préparée, plus elle constitue un socle solide pour un développement national durable et pérenne.
Dans les dynamiques sociopolitiques contemporaines, la jeunesse représente une variable stratégique essentielle au développement durable. Elle incarne une force vive, dotée d’un potentiel d’innovation, de transformation sociale et de continuité générationnelle. En Haïti, cette frange démographique majoritaire se trouve néanmoins confrontée à des mécanismes d’exclusion structurelle, notamment dans les sphères décisionnelles et politiques. Pourtant, toute trajectoire de développement pérenne repose, entre autres, sur l’implication active, éclairée et responsable de la jeunesse dans la gouvernance publique.
C’est dans cette perspective que s’inscrit la présente réflexion, qui vise à interroger de manière critique les représentations, discours et pratiques entravant la participation politique des jeunes en Haïti. En déconstruisant les stéréotypes sociétaux associés à la politique, il s’agit de mettre en lumière les stratégies discursives et idéologiques qui perpétuent l’aliénation civique, tout en appelant à une redéfinition du rôle de la jeunesse dans le processus démocratique et institutionnel.
L’analyse révèle que la société haïtienne est depuis longtemps marquée par des logiques spéculatives de peur, de méfiance et de silence vis-à-vis de la chose publique. Dès l’enfance, un discours normatif, dépourvu de fondement scientifique ou empirique, inculque aux citoyens que la politique relèverait d’un espace corrompu, immoral et dangereux. Cette vision réductrice, souvent entretenue par des acteurs politiques eux-mêmes, vise à disqualifier toute velléité d’engagement civique en dehors des cercles de pouvoir traditionnels. Ce faisant, elle consolide un ordre établi fondé sur la reproduction des élites, au détriment d’une participation citoyenne inclusive et démocratique.
Or, cette perception de la politique comme un espace intrinsèquement vicié constitue une entrave majeure à la consolidation démocratique. En tant que discipline scientifique, la science politique repose sur des principes méthodologiques, éthiques et opérationnels qui structurent la gestion de la chose publique dans toutes les sociétés modernes. La diabolisation de la politique apparaît dès lors comme un dispositif idéologique visant à exclure les catégories sociales perçues comme menaçantes pour le statu quo, en particulier les jeunes.
Dans un tel contexte, il devient impératif de promouvoir une éducation civique fondée sur la rationalité, la déconstruction des mythes politiques et la valorisation de la participation citoyenne. L’engagement politique de la jeunesse ne saurait être perçu comme un luxe ou une menace, mais comme une nécessité stratégique pour garantir la stabilité institutionnelle et le développement durable du pays. Une jeunesse formée, informée et socialement intégrée est à même de jouer un rôle central dans la transformation des structures de gouvernance et dans l’émergence d’un nouveau contrat social fondé sur l’inclusion, la transparence et la responsabilité.
En somme, l’avenir d’Haïti demeure inextricablement lié à la mobilisation consciente, organisée et structurée de sa jeunesse. Pour qu’elle puisse jouer un rôle significatif dans la construction d’un développement véritablement durable, il est impératif de l’outiller adéquatement, tant sur le plan cognitif — à travers une éducation de qualité, critique et citoyenne — que sur le plan civique,
en facilitant son accès effectif aux espaces de délibération, de décision et de pouvoir, trop longtemps monopolisés par une minorité. Cette démarche implique une rupture radicale avec les narratifs fatalistes et les représentations dévalorisantes de la politique, qui entretiennent la méfiance, l’inaction et la déresponsabilisation collective.
Car en aucune manière une science dont la mission est d’organiser, de structurer et de créer de meilleures conditions pour la bonne gouvernance de la chose publique, ainsi que de promouvoir le bien-être collectif durable d’une société, ne peut être tenue pour responsable des déboires, de l’opprobre et de l’hécatombe que connaît Haïti.
Il est désormais temps d’assumer, avec lucidité et courage, une responsabilité partagée dans la lente dégradation des fondements de la nation. Cela suppose non seulement une introspection collective, mais aussi un renversement de la logique du bouc émissaire, qui consiste à imputer systématiquement les dysfonctionnements internes à des forces extérieures. Continuer à blâmer « le Blanc », en tant que figure abstraite de l’oppression ou de l’ingérence étrangère, revient à s’exonérer de toute responsabilité historique et à retarder l’émergence d’une conscience nationale mature et souveraine.
Par exemple, il semblerait que ce même « Blanc » soit responsable de notre incapacité à débarrasser les rues de Port-au-Prince des innombrables tas de détritus qui les encombrent. De même, c’est encore lui, dit-on, qui nous aurait contraints à détourner les fonds initialement destinés à l’éducation, à la santé, aux infrastructures et à d’autres secteurs essentiels, au profit de nos propres intérêts mesquins et inavouables.
La refondation du pays passe nécessairement par une redéfinition des rapports entre générations, entre gouvernés et gouvernants, et entre les citoyens et la chose publique. Elle ne saurait aboutir sans une jeunesse haïtienne instruite, compétente, politiquement engagée et dotée d’un sens aigu de l’éthique et de la responsabilité collective. C’est à ce prix que pourra se construire une société plus juste, inclusive et tournée vers l’avenir.
Port-au-Prince, le 04 juin 2025
Par Kesnel BELEJAN
Citoyen engagé
Doctorant en science politique, spécialiste en management du DD et Études Environnementales